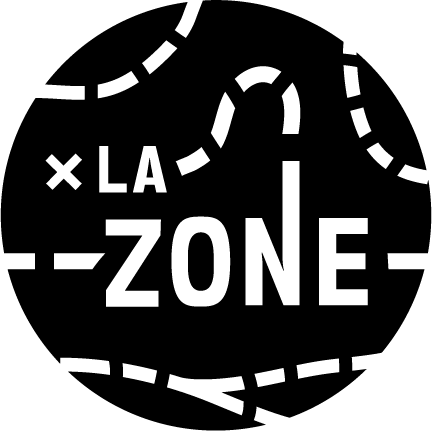JULIA BONICH : CARE & CHAOS
Julia Bonich grandit entre la Savoie et Marseille, elle étudie à Paris dans un établissement japonais où elle découvre la calligraphie et la miniature. Les œuvres de Julia mêlent ces influences et expériences aux contes, chimères, paysages et personnages qui l’ont marquée enfant. Ayant flashé sur Marseille, elle s’y est installée, y vit, y travaille et étudie aux Beaux-Arts depuis 4 ans.
Un texte écrit par Elie Chich, historien de l’art.
Riches et délicates, les illustrations de Julia Bonich empruntent tant à la miniature, dans sa tradition la plus orientale, qu’à la somme des imaginaires de fééries d’un XXIe siècle empli de l’héritage des mythologies humaines.
© Julia Bonich
Les compositions de l’artiste, tantôt saturées, tantôt aériennes, convoquent palais, tours et pavillons, de parades princières ou de paradis (du zend pairadaeza, « enceinte royale », duquel découlent les paradisus gréco-romains : d’agrément, puis jardins célestes), peuplés d’hommes et de femmes, de bêtes et de créatures fantastiques. Chacun de ces personnages, toujours soigneusement individualisés tout en incarnant des archétypes, semblent interagir les uns avec les autres, vivant histoires et aventures imbriquées et chevauchées au sein d’un cadre général, évoquant aussi bien des scènes de Brueghel que de Mir Sayyid’Ali. La profusion et la répétition de formes et de motifs, des vêtements orientaux des personnages jusqu’à la simple multitude, presque grouillante, de la foule représentée révèle un collectionnisme visuel aiguisé.
L’imaginaire magique déployé télescope thèmes et obsessions : le pavillon de tournoi voisine la princesse, qui observe la licorne, qui renvoie, enfin, par sa nature de créature soignante, aux crocs empoisonnées des manticores. Chaque élément, s’il se suffit à lui-même, est le ciment d’un monde en soit propre à chaque composition. Ces épisodes de vies de saint·es profanes s’articulent comme des scènes de dévotion, en témoignent par exemple ces mains coupées et volantes, ex-voto sanglants surplombant des apocalypses joyeuses, entre danses macabres de squelettes, éruptions volcaniques et combats de lions, soulignant une dynamique frénétique et ludique. Ces univers autonomes sont des hommages multiples, à l’histoire, aux formes, à l’imaginaire qui les transforment et les mythifient.
© Julia Bonich
Un texte écrit par Léa Lefebvre
« Les détails sont choisis pour leur beauté intrinsèque et ils reflètent le goût de celui qui les a sélectionnés », Daniel Arasse – Le Détail, 1992.1
Julia collectionne, archive, compile méticuleusement des personnages, motifs et attributs qu’elle réorganise en des compositions saturées. Ses illustrations syncrétisent et concrétisent détails, traces et archétypes historiques, mythologiques et artistiques, sacrés comme profanes. Joyeux charivaris, ses scènes hybrides posent sur papier, plexiglas comme miroir, des bribes de notre inconscient collectif. Pas d’ordre ou de hiérarchie, ses traits précis érigent en sujet l’anecdotique comme l’ornement, témoins intemporels des mœurs, ères et époques.
Transcendance et commun, c’est ce qu’elle a trouvé à Marseille, qu’elle définit par ses festivités, ses rassemblements célébratifs. En toutes situations : la fête, qu’elle soit deuil, revendication, carnaval, bordel, ou tout ça à la fois. Une ville qui fonctionne en ensemble, où les détails comptent, quitte à dépareiller pour ré-assembler. Dans les dessins de Julia, la subversion des normes n’est pas temporaire : pas de victoire de l’ordre sur le chaos. Rites, mort·es et érotisme ensemble dans ce carnaval, rituel magique à la gloire de la confusion sociale et de la liberté : célébration de la « régression du cosmos dans le chaos » (Mircea Eliade).2 A la manière d’Aby Warburg3, Julia s’intéresse aux pratiques créatrices mineures : fêtes, carnavals, artisanat, rites, mais aussi le dessin, comme témoins d’une époque. Face à une insignifiance supposée, Julia apporte le même soin aux détails de ses œuvres qu’aux détails de l’histoire.
© Julia Bonich
Loin des modernes minimalistes, Julia s’inscrit dans la décadence. Pas d’unité de l’œuvre et d’instantanéité de son effet (Grimm, XVIIIe siècle),4 il faut « déguster les détails », et tant pis pour l’unité idéale, tant pis pour la distance classique : il faut s’approcher, patiemment scruter, laisser son oeil vaquer librement.
Face à une modernité libérale rationalisée, Julia offre un réenchantement ; plus qu’un remède, un ailleurs. Pas de limites à celui-ci, qu’elles soient géographiques comme historiques : il s’étend dans l’immensité de nos représentations collectives. Impossible à cartographier, il est la cartographie elle-même. Elle présente un refuge hors du temps, où mystère, nature et culture s’harmonisent, où ses codes occidentaux honorent les influences asiatiques. A la raison, à la technique et au profit, Julia oppose la pratique lente et méditative du dessin sur supports pauvres, mais aussi une perspective relevée aux multiples points de fuite et sources de lumière, hommages à la miniature indienne. Si violence il y a, des phénomènes naturels comme combats, c’est la puissance qui est célébrée, comme la sensibilité des squelettes et ensanglantées aux ballets frénétiques.
L’univers syncrétique de Julia n’est troublé que par la présence de mains-démiurges : celles qui créent et façonnent un monde, partant de la matière existante. Sensibles par excellence, ces organes préhensibles sont autant des deus ex machina que les mains de l’artiste. Elles peuvent expliquer le point de vue omniscient, dans des œuvres dévoilant églises en coupe et scènes intimes, nudités apaisées et puissant érotisme, sans voyeurisme. Elles nous lient à la position de l’artiste, à son regard. La scopophilie5 est évacuée : le plaisir de posséder autrui, la pulsion sexuelle freudienne qui vise à soumettre l’autre à son regard contrôlant. Si les personnages présentés semblent s’être construits sous un œil masculin, en objets de son désir, ils s’en affirment libérés. L’intérêt de Julia pour le gynécée relève de cette même liberté, permise et donnée dans cette partie de maison grecque et romaine réservée aux femmes à l’Antiquité. En dessin comme en volume, Julia collecte les détails et fantasme cette contrainte genrée, mêle jouets, attributs et symboles en des rencontres improbables, célébrées et accompagnées par moultes dentelles, strass bons marchés, chaînes bling et toisons léopards.
© Julia Bonich
Pour suivre le travail de Julia Bonich : yulialavia
Pour aller plus loin :
- Daniel Arasse, Le Détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992, p.7. ↩︎
- Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, Gallimard, 1965, p. 71 – 72. ↩︎
- Aby Warburg, L’Atlas mnémosyne : avec un essai de Roland Recht, L’écarquillé-INHA, 2012 ↩︎
- Daniel Arasse, Le Détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992, p.56 ↩︎
- Laura Mulvey, Plaisir visuel et cinéma narratif, 1975, Screen. ↩︎